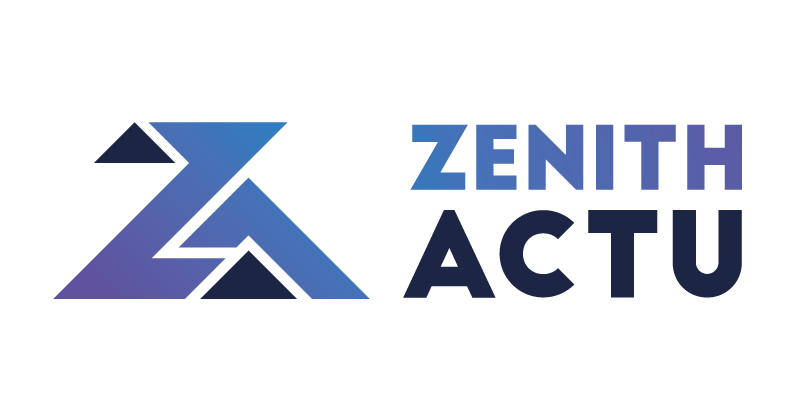En mars 2024, plusieurs universités américaines ont restreint l’usage de ChatGPT pour la production de travaux académiques, évoquant des problèmes de fiabilité et des risques de plagiat. La CNIL, en France, a publié la même année une mise en garde sur la gestion des données personnelles par les intelligences artificielles génératives.
Des chercheurs en sécurité informatique ont aussi mis en évidence la capacité de ChatGPT à générer, malgré ses filtres, du contenu sensible ou trompeur. Les professionnels de la santé mentionnent l’impossibilité de garantir l’exactitude des réponses médicales fournies par l’outil.
ChatGPT : un outil puissant, mais loin d’être infaillible
ChatGPT, conçu par OpenAI, a bouleversé la façon dont on imagine l’intelligence artificielle. Ce modèle de langage naturel, fruit de l’évolution de GPT-3 à GPT-4 puis GPT-4o, s’illustre par des performances bluffantes en rédaction automatique, traduction, ou assistance virtuelle. On le retrouve partout : dans les chatbots, les services clients, les outils de synthèse, et jusque dans les brainstormings des développeurs. Accessible sans frais ou via des abonnements Plus et Enterprise, il a vite conquis aussi bien les particuliers que les grandes entreprises.
Mais derrière cette façade impressionnante, les failles se dessinent vite. ChatGPT n’est pas sans limites, loin de là. Voici quelques-unes des contraintes rencontrées au quotidien :
- nombre de requêtes limité dans certaines versions,
- gestion du contexte parfois aléatoire d’une conversation à l’autre,
- absence d’accès à Internet pour la version gratuite.
ChatGPT ne ressent rien, ne comprend pas vraiment le sens profond de ce qui lui est demandé. Il se contente de recracher, avec style, des réponses façonnées par son entraînement, parfois daté, incomplet, voire biaisé. Cela fragilise la pertinence de ses suggestions, surtout lorsqu’il s’aventure sur des terrains sensibles.
Le recours à ChatGPT dans certains domaines doit donc être manié avec précaution. Voici des exemples où la prudence s’impose :
- Diagnostic médical : l’outil n’a ni la légitimité ni l’expertise pour analyser des situations cliniques.
- Conseil juridique : ses réponses ne sont pas garanties par un cadre légal fiable ou actualisé.
- Accompagnement psychologique : aucune validation scientifique, aucune garantie éthique.
La version GPT-3.5, encore largement utilisée, montre vite ses limites face à GPT-4, notamment dans la gestion du contexte conversationnel et la créativité. Quiconque s’y frotte apprend à ne jamais prendre pour argent comptant ce qui sort de la machine. L’illusion d’une intelligence universelle se heurte, au fil des échanges, à la complexité du langage humain et à la volatilité des données récentes.
Peut-on vraiment faire confiance aux réponses générées par l’IA ?
La fluidité des textes générés par ChatGPT a de quoi dérouter. À première vue, tout semble solide, construit, presque irréprochable. Mais derrière le vernis, la confiance s’effrite. L’IA s’appuie sur d’immenses jeux de données glanés sur le web, où se mêlent biais, trous et approximations.
Les utilisateurs les plus vigilants le savent : ChatGPT peut affirmer des contre-vérités avec aplomb, inventer des informations, parfois même relayer de fausses actualités. Ce phénomène, on le nomme hallucination. L’algorithme va jusqu’à inventer des sources ou mélanger des faits, brouillant la frontière entre réalité et fiction. Cette faille n’est pas anecdotique, surtout quand il s’agit de sujets sensibles comme la santé, le droit ou l’actualité.
Quelques points méritent d’être gardés à l’esprit :
- Biais : l’outil n’efface pas les biais présents dans ses bases d’apprentissage, il peut même les amplifier.
- Désinformation : une phrase fausse mais bien formulée peut passer inaperçue et tromper même des connaisseurs.
- Manque de vérification : l’IA cite rarement ses sources, et ne distingue pas toujours le fait avéré du propos spéculatif.
OpenAI tente de corriger ces défauts, mais la responsabilité de vérifier les réponses revient à l’utilisateur. Rien ne vaut l’esprit critique et la vérification croisée. Les textes produits par ChatGPT doivent être considérés comme des pistes à explorer, jamais comme des vérités toutes faites.
Quand l’intelligence artificielle met en jeu la sécurité des données et la vie privée
La montée en puissance de ChatGPT pose des questions de fond sur la sécurité et la confidentialité des données. À chaque interaction, le système collecte et traite une masse considérable d’informations personnelles. Ce constat n’a pas échappé à la CNIL, ni à d’autres autorités européennes, qui rappellent les dangers liés à la perte de maîtrise des données partagées.
Respecter le RGPD s’avère complexe ici. Le règlement européen impose le contrôle du traitement, la gestion et l’effacement des données. Or, OpenAI n’offre pas la possibilité de supprimer une question ou une phrase si elle a servi à l’entraînement du modèle. L’utilisateur n’a donc aucune garantie de pouvoir effacer ce qu’il confie à l’IA.
Chaque prompt, chaque texte généré est susceptible d’être stocké, analysé, voire exploité pour améliorer l’algorithme. Pour les professions soumises au secret ou à des règles strictes de confidentialité, la prudence est de mise. La propriété intellectuelle et la protection des secrets professionnels deviennent des enjeux concrets dès qu’il s’agit d’utiliser ce type d’outil.
Des cas illustrent bien ces risques :
- Des fuites de données ont déjà été signalées, exposant des contenus sensibles via ChatGPT.
- Les gouvernements et institutions telles que l’UNESCO multiplient les initiatives pour mieux encadrer l’usage de l’intelligence artificielle et protéger la population.
Le contrôle institutionnel se renforce. Désormais, les discussions ne se limitent plus à la technique : elles touchent l’éthique, le droit, la responsabilité. Professionnels, entreprises ou simples particuliers, chacun doit mesurer ce qu’il risque en partageant des informations sensibles avec une IA générative.
Adopter une utilisation responsable : quelles précautions pour limiter les risques ?
L’essor de ChatGPT touche tous les secteurs : entreprises, administration, éducation. Pourtant, la prudence s’impose dès qu’il s’agit de générer du contenu de façon automatique. Il est primordial de ne jamais saisir d’informations sensibles, données bancaires, dossiers médicaux, secrets industriels, sous peine de voir ces éléments intégrés à l’entraînement du modèle ou, pire, récupérés à mauvais escient.
Quelques habitudes permettent de réduire l’exposition aux risques :
- Privilégier l’anonymisation des informations avant toute utilisation.
- Écarter tout partage de données confidentielles ou stratégiques.
- Vérifier systématiquement l’exactitude des contenus générés avant de les utiliser.
La cybersécurité devient un enjeu central. ChatGPT, mal utilisé, peut servir à rédiger des mails de phishing ou à orchestrer des campagnes de désinformation. Les spécialistes préviennent : chaque utilisateur peut devenir, sans le vouloir, une porte d’entrée pour des cyberattaques. La vigilance doit être collective, surtout sur les plateformes collaboratives et les réseaux sociaux.
Les entreprises s’organisent : chartes d’utilisation, formations ciblées, sensibilisation des équipes, notamment dans les services juridiques, RH, marketing ou tout secteur soumis à des contraintes réglementaires. Médecins, psychologues, avocats ou autres professions à responsabilité ne devraient jamais s’appuyer sur ChatGPT pour des conseils personnalisés ou l’analyse de cas individuels.
Face aux réponses générées, rester lucide et critique s’impose : tester, comparer, analyser. Les faiblesses de ChatGPT ne se limitent pas à la technique ; elles concernent aussi la façon dont chacun s’approprie, diffuse ou valide l’information. Rester vigilant, c’est garder la main sur ce que l’on crée et partage avec l’intelligence artificielle.
ChatGPT n’est pas un oracle. Il appartient à chacun de choisir avec discernement ce qu’il partage, ce qu’il croit, et ce qu’il relaie. L’ère de l’IA générative ne fait que commencer ; la vigilance collective, elle, ne doit jamais fléchir.